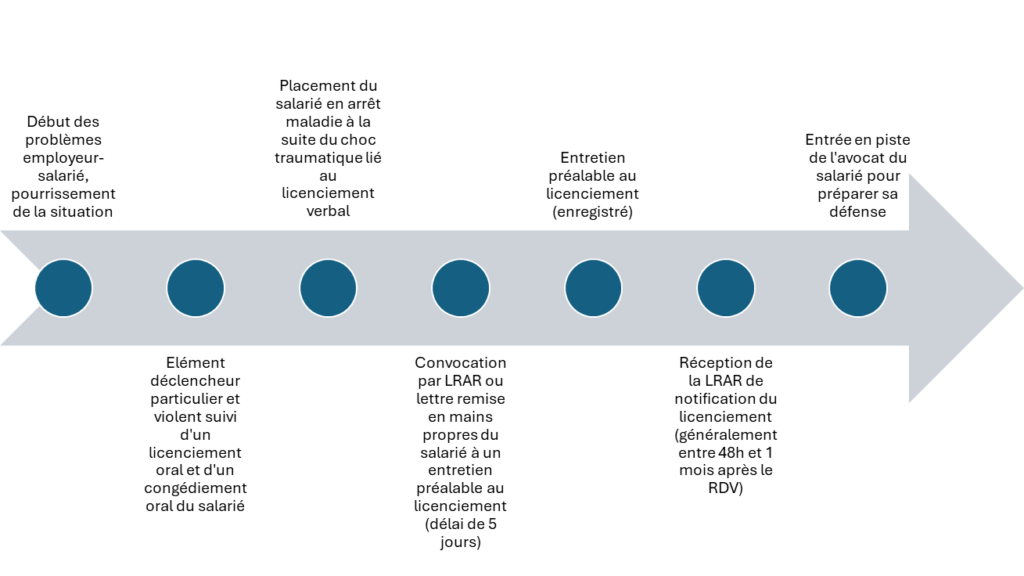Un outil légitime… mais aux dérives inquiétantes
Les commissions d’enquête parlementaire sont, en principe, un instrument précieux de notre démocratie. Elles permettent au Parlement d’exercer sa mission de contrôle sur l’action du Gouvernement. Ce pouvoir est reconnu par la Constitution, et son exercice est encadré par l’ordonnance du 17 novembre 1958.
Mais ces dernières années, certaines commissions ont franchi une ligne rouge : celle qui sépare le rôle parlementaire du rôle judiciaire. En s’intéressant à des faits objets de procédures pénales en cours, voire en agissant comme si elles disposaient d’un pouvoir juridictionnel, ces commissions mettent en péril les droits fondamentaux des personnes concernées.
Un fonctionnement hors du cadre du procès équitable
Contrairement à la procédure judiciaire, celui qui est convoqué devant une commission d’enquête ne bénéficie d’aucune garantie fondamentale :
- Il ne peut se taire : refuser de répondre est un délit passible de deux ans d’emprisonnement (article 6 de l’ordonnance de 1958).
- Il n’a pas accès à un dossier pour connaître les faits qui lui sont reprochés.
- Il ne peut discuter les témoignages ou les éléments avancés contre lui.
- Il ne peut faire valoir son droit à la contradiction.
- Il ne bénéficie d’aucune présomption d’innocence effective, dans un contexte souvent médiatique et orienté.
Ces carences sont d’autant plus graves que certaines commissions n’hésitent pas à convoquer des personnes impliquées dans des affaires judiciaires non jugées, voire en cours d’instruction, brouillant dangereusement les frontières entre justice et politique.
Des précédents préoccupants : entre idéologie et instrumentalisation
Le cas récent de la commission d’enquête sur les violences sexuelles et sexistes dans le milieu culturel, présidée par Sandrine Rousseau, illustre cette dérive.
Plusieurs affaires évoquées faisaient déjà l’objet de procédures pénales. Les mis en cause n’ont pas pu réagir aux témoignages, ni exercer aucun droit de défense.
Pire encore : certains ont été publiquement présentés comme coupables sans jugement, y compris lorsque des enquêtes les avaient totalement disculpés, comme ce fut le cas pour Julien Bayou.
Ce n’est pas la première fois qu’une commission parlementaire dépasse les bornes. En 2018, celle consacrée à l’affaire Benalla a elle aussi empiété sur des procédures en cours, malgré les protestations de principe de ses membres.
Une jurisprudence claire… mais trop souvent ignorée
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’un jugement ne peut se fonder sur des déclarations issues d’une commission d’enquête, faute de garanties du procès équitable.
De même, la Cour d’appel de Paris a récemment invalidé certains éléments tirés d’une commission au motif qu’ils relevaient exclusivement du pouvoir judiciaire.
Les avertissements sont donc clairs. Pourtant, ils restent lettre morte pour certaines commissions, au mépris des principes fondamentaux.
Quand le dogme prend le pas sur le droit
La désignation de présidents de commission à la ligne idéologique tranchée contribue à cette dérive. L’exemple de Sandrine Rousseau, dont les déclarations publiques ne laissent aucun doute sur son positionnement militant, est symptomatique.
Il en va de même pour Meyer Habib, à la tête de la commission sur l’affaire Sarah Halimi, qui avait publiquement exprimé sa conviction quant à la préméditation du crime avant même le début des travaux.
Cette politisation nuit gravement à la crédibilité des commissions et alimente une défiance envers l’institution parlementaire elle-même.
Une confusion des rôles délétère pour tous
Le Parlement n’est ni un juge, ni un procureur. Ses missions de contrôle doivent rester distinctes de celles de l’autorité judiciaire.
En mélangeant les genres, certaines commissions :
- sapent la confiance dans la justice,
- violent la séparation des pouvoirs,
- portent atteinte à la réputation de personnes non jugées,
- instrumentalisent des causes pourtant sérieuses à des fins politiques.
Ce qu’il faut retenir
Les commissions d’enquête parlementaire sont un outil démocratique puissant… mais dangereux lorsqu’il est mal utilisé.
Leur pouvoir coercitif devrait s’exercer dans un cadre strictement respectueux des droits de la défense, de la présomption d’innocence, et de la séparation des pouvoirs.
Faute de quoi, elles deviennent un instrument de mise en accusation publique sans procès, avec les ravages que cela suppose pour les personnes mises en cause – et, plus largement, pour l’État de droit.
En conclusion
Il est urgent de réinterroger le cadre juridique des commissions d’enquête, et d’imposer des garanties minimales aux personnes convoquées.
De même, la désignation de leurs présidents ne peut relever de choix militants, au risque de décrédibiliser totalement leurs travaux.
L’État de droit ne peut tolérer qu’un organe parlementaire fonctionne sans les garde-fous que la justice impose à toute procédure accusatoire.
Vous êtes convoqué devant une commission d’enquête ?
Vous vous interrogez sur vos droits et obligations ?
N’hésitez pas à me contacter. Je peux vous accompagner dans vos démarches et assurer la défense de vos intérêts.