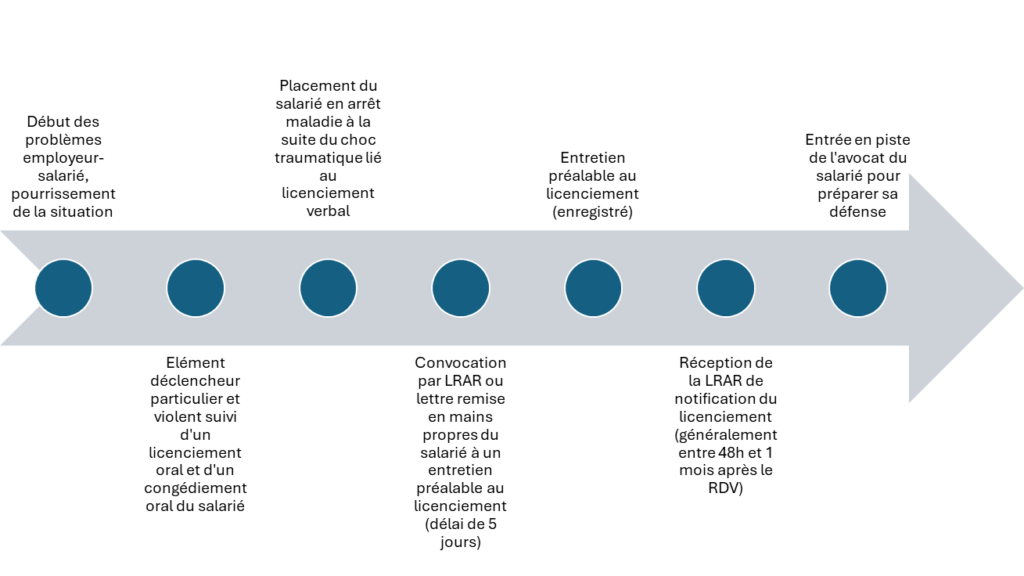Un silence complice entre experts médicaux
Les experts médicaux (médecins, docteurs, spécialistes, chirurgiens, professeurs de médecine, etc.) occupent une place cruciale dans le système judiciaire. Leurs avis sont déterminants dans les affaires de responsabilité médicale, d’accidents corporels ou d’indemnisations. Pourtant, une singularité choquante persiste : à la différence des autres experts judiciaires (ingénieurs, financiers, experts en bâtiment, etc.), ils ne critiquent jamais le travail de leurs confrères. Cette omerta, qui repose sur un réflexe de caste, nuit à l’équité des décisions de justice et empêche l’établissement du contradictoire, pourtant fondement essentiel du droit.
L’absence de contradictoire : une dérive systémique
Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse discuter et contester les arguments et preuves adverses. Dans la plupart des domaines judiciaires, un expert peut voir son analyse remise en cause par un autre spécialiste. Mais en matière médicale, les experts forment un corps soudé où la critique interne est quasi inexistante. Ce refus de remise en question empêche l’émergence d’une véritable discussion technique et scientifique, laissant les victimes démunies face à des expertises biaisées ou insuffisantes.
Pourquoi ce silence ? Plusieurs raisons peuvent être avancées :
- La peur des représailles : critiquer un confrère, c’est risquer d’être marginalisé dans le milieu médico-légal.
- L’entre-soi corporatiste : les experts sont souvent issus du même cercle professionnel et partagent une culture de protection mutuelle.
- Le manque d’indépendance : de nombreux experts exercent parallèlement dans des hôpitaux ou cliniques et peuvent craindre des conséquences sur leur carrière.
Des conséquences graves pour les victimes
Cette absence de contradiction a des effets dramatiques. Lorsqu’un patient souffre des conséquences d’une faute médicale, il espère que la justice reconnaisse le préjudice subi. Mais si l’expert mandaté minimise l’erreur ou l’écarte sans justification suffisante, la victime se retrouve sans recours. Un contre-expert pourrait théoriquement rectifier la situation, mais en pratique, ces critiques sont très rares.
Les assureurs et les médecins poursuivis en responsabilité savent tirer profit de cette solidarité implicite. Ils peuvent s’appuyer sur des expertises peu contestées pour éviter des indemnisations coûteuses ou contourner leur responsabilité. Ainsi, la confiance dans l’impartialité du système judiciaire s’effrite, alimentant un sentiment d’injustice.
Quelles solutions pour rétablir un véritable débat contradictoire ?
Pour briser cette omerta et garantir des expertises plus objectives, plusieurs réformes sont envisageables :
- Favoriser la pluralité des expertises : imposer des expertises collégiales avec des professionnels de sensibilités différentes.
- Encourager la confrontation des avis : permettre aux parties d’exiger une contre-expertise systématique et d’avoir accès à des experts indépendants.
- Réformer le statut des experts judiciaires : s’assurer que les experts sont réellement indépendants et ne subissent aucune pression extérieure.
- Sanctionner les expertises partiales : mettre en place un véritable contrôle de qualité des expertises et sanctionner les experts qui manquent à leur devoir d’objectivité.
Conclusion
L’expertise médicale est un maillon essentiel du système judiciaire. Pourtant, son fonctionnement actuel, marqué par un esprit de corps excessif, va à l’encontre des principes fondamentaux du droit. Il est urgent d’instaurer de véritables contre-pouvoirs pour que l’expertise médicale ne soit plus un instrument de protection des fautes, mais un outil au service de la justice et des victimes.