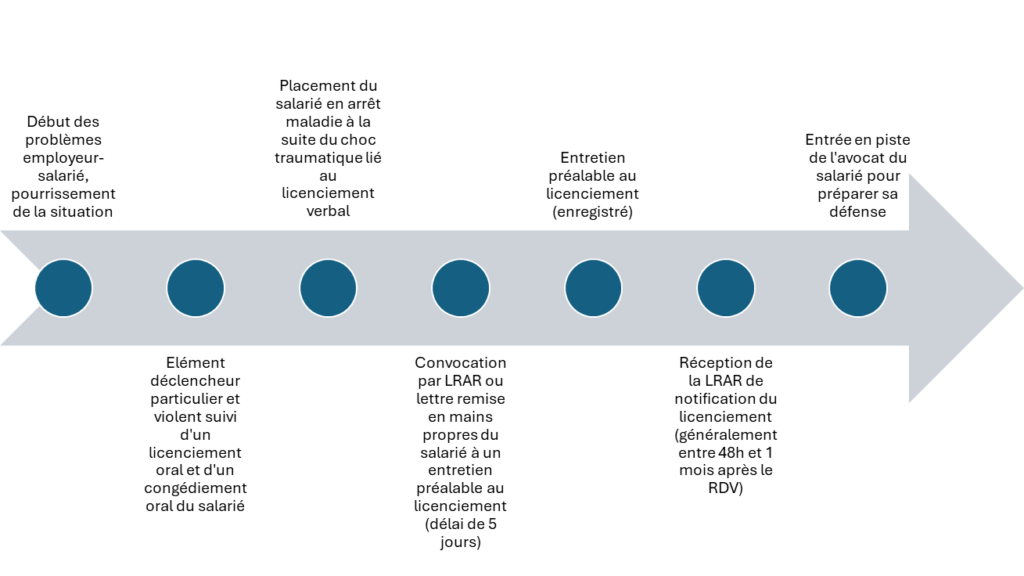Parce qu’elle interdit les poursuites pénales au bout d’un certain temps, la prescription est souvent critiquée. Dans une société où la mémoire des faits ne s’efface jamais, où les archives et les témoignages circulent indéfiniment sur Internet, elle apparaît parfois comme un instrument d’impunité, notamment en matière d’infractions sexuelles.
La prescription fait partie de ces quelques notions de droit qui sont au centre de débats publics compliqués. Elle heurte traditionnellement l’opinion car elle permet, pense-t-on, aux criminels d’échapper aux sanctions qu’ils méritent.
Mais un État qui poursuivrait sans limite crimes et délits serait-il encore un État de droit ? Une société incapable d’oubli pourrait-elle être juste ? Et que resterait-il des preuves, quarante ou cinquante ans après les faits ?
La prescription demeure un principe essentiel de la justice pénale : elle garantit un équilibre entre le besoin de répression et les impératifs de sécurité juridique, tout en évitant une justice viciée par l’érosion du temps.
Ce ne sont pas seulement les droits de la défense qui justifient une prescription, mais aussi la protection d’intérêts sociaux importants et légitimes.
La nécessité de la sécurité juridique
Le droit pénal ne se limite pas à punir : il vise aussi à assurer la stabilité des rapports sociaux. La prescription répond à cette exigence en empêchant qu’une personne ne soit poursuivie indéfiniment pour des faits anciens.
Laisser ouvertes à l’infini les portes de la justice, c’est maintenir les individus sous une menace permanente. Une société où nul ne pourrait jamais considérer son passé comme révolu serait une société où la peur l’emporterait sur le droit. La prescription fixe ainsi un cadre temporel raisonnable, garantissant que l’action pénale se déroule dans un délai permettant encore d’établir la vérité avec rigueur.
Le risque de dépérissement des preuves
Avec le temps, les preuves matérielles s’effacent, les témoins disparaissent ou leurs souvenirs se déforment. La prescription protège la justice contre ces dérives en empêchant que des accusations tardives ne reposent sur des éléments trop fragiles.
La détérioration des preuves empêche de juger et l’accusé de se défendre
Quand ce risque est trop élevé, le procès n’a plus de sens et ne contentera personne.
L’absence de sens à la peine
L’absence de sens à une peine infligée longtemps après les faits quand l’auteur des actes a changé.
Un coupable peut changer avec le temps, au point que le condamner des décennies plus tard ne fait plus sens : il ne correspond plus à l’homme ou à la femme qu’il était au moment des faits et ne représente plus de danger pour la société. La justice n’a pas pour but de se venger, mais d’assurer un équilibre entre réparation et réinsertion.
Le temps fait disparaitre le risque de récidive, c’est-à-dire le risque couru par la société et qui motive l’emprisonnement du coupable.
Avec le temps, le trouble social causé par l’infraction diminue : l’utilité publique de punir est moins grande
Le risque de mirage pour les victimes
Les victimes que l’on a voulu protéger sont entretenues dans l’idée qu’une procédure pénale et de longues années de prison suivront automatiquement leur dépôt de plainte alors qu’il n’en sera rien, faute de preuves le plus souvent.
Les moyens limités
Sans délais de prescription, la police et la justice se retrouveraient avec un stock immense d’affaires à traiter, très supérieur à leurs moyens, et ne pourraient plus accorder la priorité aux affaires les plus récentes, souvent les plus urgentes.
Un équilibre entre droits et devoirs
Accorder un droit implique d’en fixer les limites. Une victime doit agir dans un délai raisonnable pour permettre une justice effective. À l’inverse, maintenir un individu sous la menace d’une condamnation toute sa vie reviendrait à lui refuser la possibilité de reconstruire son existence.
Cette question est particulièrement sensible dans les infractions sexuelles, où les délais de prescription ont été considérablement allongés. Tant qu’une victime sait que la justice peut encore être saisie, elle reste enfermée dans son statut de victime, dans une attente parfois douloureuse. Une société qui refuse d’accorder l’oubli à ses citoyens risque de figer les blessures, et d’empêcher la reconstruction tant des victimes que des auteurs des faits.
Pourquoi la prescription existe-t-elle ?
La prescription est un principe fondateur du droit, hérité du droit romain et consacré sous Napoléon dans le Code d’instruction criminelle de 1808. Elle repose sur plusieurs fondements, rappelés notamment par un rapport parlementaire de 2014 :
Des principes fondamentaux :
- Le droit à l’oubli, pour préserver la paix sociale : « le trouble causé s’apaiserait progressivement avec le temps ».
- Le pardon légal, reconnaissant que le temps peut transformer un individu, qu’il a déjà subi l’épreuve de la peur et du remords. L’enjeu est de concilier la sanction des infractions et la réinsertion sociale.
- La proportionnalité, car la gravité d’une infraction doit déterminer la durée durant laquelle elle peut être poursuivie.
Des garanties pour un procès équitable :
- Le dépérissement des preuves, qui rend difficile une condamnation juste et fondée.
- La fragilité des témoignages, exposés à l’érosion du souvenir et aux reconstructions inconscientes.
- Le risque de frustration pour les victimes, si un procès tardif échoue faute d’éléments suffisants.
Une nécessité pour l’institution judiciaire :
- La rapidité de la justice, car un procès ne doit pas intervenir des décennies après les faits sous peine de perdre toute efficacité.
- La gestion des dossiers, la prescription permettant d’éviter l’engorgement des tribunaux en concentrant les ressources sur des affaires récentes et encore solvables en termes de preuve.
Les techniques pour déroger à la prescription
- allonger le délai de prescription
- reporter le point de départ du calcul par exemple à la majorité de la victime
- suspendre la prescription en cas de dissimulation
Le risque posé par les attaques contre la prescription
les risques que l’émotion fait courir au droit pénal, et spécialement du fait que la critique féministe de la prescription s’accompagne souvent aussi d’une critique des règles de preuves et de la présomption d’innocence. C’est le fameux « on vous croit » du mouvement Me Too, compréhensible à certains égards mais qui demande à être mis en perspective si l’on ne veut pas quitter les rives du droit libéral. La jonction entre cette critique de la prescription et celle de l’administration de la preuve nourrit ici la tentative d’une justice populaire médiatique alternative.
Cette évolution est d’autant plus dommageable que la remise en cause de ces règles libérales pourrait ne pas se limiter au domaine de la délinquance sexuelle et toucher d’autres types de faits.
Conclusion
La prescription peut frustrer ceux qui veulent voir la justice s’exercer coûte que coûte, mais elle est une nécessité pour garantir un procès équitable, préserver la stabilité sociale et éviter que la justice ne devienne un instrument de vengeance perpétuelle.
Elle ne fait pas disparaître l’infraction, ni la douleur de la victime, mais impose à la société de fixer des limites, d’accepter que tout ne peut être jugé indéfiniment. C’est une exigence de droit, mais aussi d’humanité.
Lectures
Eloge de la prescription, Marie Dosé
Jean Danet, Prescription et justice pénale – Contre les illusions de l’éternité, Editions Dialogue, mars 2024, 6,90€