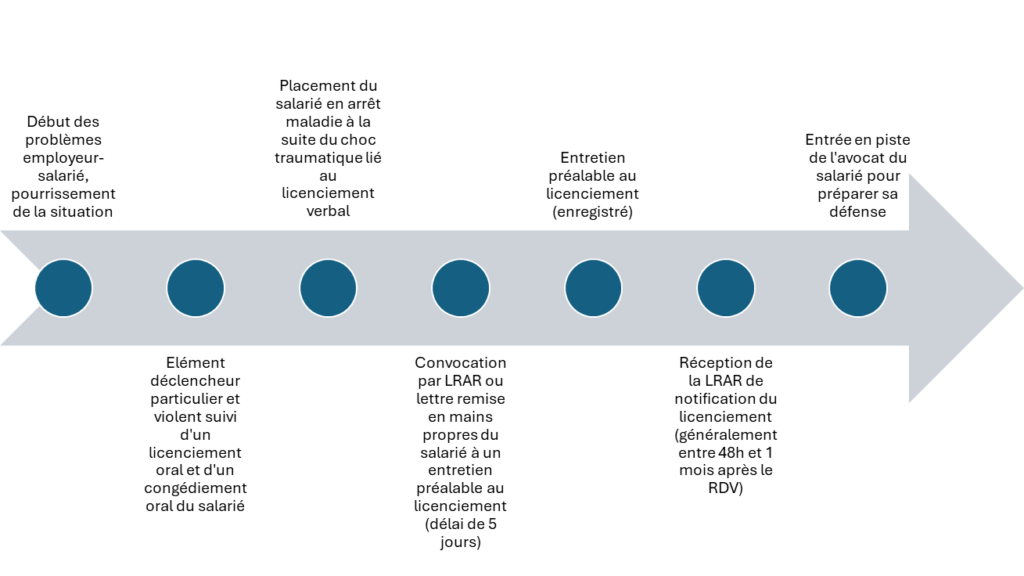Les deux sont des quasi-contrats qui sont, au même titre que les contrats, les délits, les quasi-délits et la loi, des sources d’obligations(C. civ., art. 1100 et 1300).
Alors que le Code civil de 1804 n’envisageait que deux quasi-contrats, la gestion d’affaire et le paiement de l’ indu , l’ordonnance du 10 février 2016 a consacré l’ enrichissement sans cause, qui avait été dégagé par la jurisprudence il y a plus d’un siècle, rebaptisé « enrichissement injustifié », en raison de la disparition de la cause
Le paiement de l’indu
Le paiement de l’indu implique qu’une personne (l’accipiens c’est-à-dire celui qui a reçu paiement) reçoive d’une autre (le solvens, celui qui a payé) un paiement qui ne lui était pas dû, ce qui ouvre droit à une action en répétition de l’indu au profit du solvens. (C. civ., art. 1302 à 1302-3.)
L’article 1302-1 prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 1302-1 couvre deux hypothèses.
- Article 1301-1 : celle dans laquelle il n’existe aucune dette (indu objectif), ce qui n’est pas le cas lorsqu’une dette est bien due mais qu’elle a été payée en violation de l’ordre des privilèges (Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-22.549)
- Article 1301-1 : une personne s’acquitte d’une dette dont elle est bien la débitrice, mais entre les mains du mauvais créancier (première variété d’ indu subjectif)
- L’article 1302-2 (2ème variété d’indu subjectif) : lorsqu’une personne s’acquitte d’une dette dont elle n’est pas débitrice, entre les mains du bon créancier, soit du fait d’une erreur, soit à cause d’une contrainte. “
“Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.”
Un tableau pour y voir plus clair :
| 1302-1 (indu objectif) | 1302-1 (indu subjectif) | 1302-2 (indu subjectif) | |
| Nature de la dette | Aucune dette n’existe | Dette existe et due par le payeur | Dette existe mais pas due par le payeur |
| Accipiens | Tiers non créancier | Tiers non créancier (mauvais créancier) | Créancier véritable |
| Solvens | Tiers non débiteur | Débiteur véritable | Tiers non débiteur |
| Justification | Aucune nécessaire | Aucune nécessaire | Erreur ou contrainte |
| Type d’indu | Objectif | Subjectif (paiement de la dette d’autrui) | Subjectif (paiement de la dette d’autrui) |
| Faute du solvens | Indifférente | Dommages-intérêts possibles | Dommages-intérêts possibles |
L’enrichissement injustifié
Le Code civil de 1804 ne contenait aucun texte consacrant de manière générale la possibilité d’une action découlant d’un enrichissement sans cause. Pour une partie de la doctrine, il s’agissait de la traduction du principe selon lequel nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui et de la matrice des quasi-contrats .
1303-1 “L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.”
Celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement (C. civ. art. 1303, al. 1), à moins notamment que l’appauvri ait eu un intérêt personnel à l’acte dont il demande l’indemnisation (art. 1303-2, al. 1).
Cinq conditions doivent être réunies pour permettre l’exercice de l’action de in rem verso, autrefois appelée enrichissement sans cause et maintenant enrichissement injustifié :
- L’existence d’un appauvrissement au détriment du demandeur. Cet appauvrissement doit être apprécié en argent au jour de sa réalisation. Il peut résulter d’une dépense ou d’un gain manqué ;
- L’existence d’un enrichissement du défendeur, apprécié en argent au jour où l’action est intentée. Cet enrichissement peut résulter d’un accroissement de son actif ou d’une diminution de son passif (Il y a diminution du passif du défendeur en cas de dette payée par autrui)
- l’existence d’une corrélation entre l’appauvrissement et l’ enrichissement , celle-ci pouvant être directe ou indirecte ;
- L’absence de cause ou d’intérêt personnel de l’appauvri à l’acte, ce qui signifie que l’action est fermée en présence d’une cause qui justifie l’appauvrissement du demandeur et l’enrichissement corrélatif du défendeur. Cette cause peut résulter de la loi, d’une décision de justice ou d’un acte juridique L’article 1303-1 consacre cette exigence en disposant que « l’ enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ». Exemples : pour les travaux de rénovation sur un immeuble (Cass. 1e civ. 24-9-2008 no 07-11.928 FS-PBI : Bull. civ. I no 212) ou l’entretien d’une rivière (Cass. 3e civ. 20-5-2009 no 08-10.910 FS-PB : RJDA 11/09 no 933). À la fin du bail, le locataire d’une maison ne peut pas demander au bailleur, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, une indemnité pour les panneaux photovoltaïques qu’il a installés dans son intérêt personnel. Le locataire d’une maison d’habitation installe des panneaux photovoltaïques sur le toit de celle-ci avec l’autorisation du bailleur. Ayant reçu de ce dernier un congé pour reprise pour habiter, le locataire réclame une indemnisation à hauteur du coût de l’installation (16 000 €) sur le fondement de l’enrichissement injustifié. Une cour d’appel fait droit à la demande, retenant que le propriétaire tire désormais profit des panneaux sans en avoir supporté le coût, ce qui constitue un enrichissement injustifié au détriment de l’ancien locataire, privé depuis son déménagement de tout droit sur l’immeuble amélioré. La Cour de cassation a censuré cette décision. En effet, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel (C. civ. art. 1303-2, al. 1). La cour d’appel n’avait pas recherché, comme il le lui était demandé, si le locataire n’avait pas réalisé les travaux en vue d’un profit personnel.Cass. 1e civ. 8-1-2025 no 23-19.020 F-D
- la subsidiarité de l’action, cette dernière étant réservée à celui qui ne dispose d’aucun autre moyen pour faire valoir ses droits.(Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18-14.673 ; « L’action fondée sur l’enrichissement sans cause ayant un caractère subsidiaire et ne pouvant être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur »). L’action de in rem verso ne peut donc être utilisée pour pallier l’impossibilité d’exercer une autre action (V. par ex. : Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 17-25.934. – Cass. 1re civ., 2 nov. 2005, n° 02-18.723 ; « qu’il appartenait à la société Brout d’établir que Mlle X avait commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule ; qu’en l’absence d’une telle preuve, elle ne pouvait obtenir le paiement de ces travaux sur le fondement du contrat qui les liait ou exercer une action ‘‘de in rem verso”en faisant abstraction de celui-ci ».
Afin d’éviter les contestations, les parties au bail, y compris s’il s’agit d’un bail commercial, ont tout intérêt à régler le sort des améliorations apportées aux locaux loués, soit dès le bail initial, soit, par exemple, lorsque celles-ci nécessitent l’autorisation du bailleur, par un avenant conclu à cette occasion. Mais encore faudra-t-il qu’elles trouvent un accord sur ce point.
Quelle est la différence entre enrichissement sans cause et enrichissement injustifié ?
L’ordonnance de 2016 réformant le droit des contrats et des obligations a principalement codifié le régime jurisprudentiel de l’enrichissement sans cause, désormais appelé enrichissement injustifié. Il ne s’agit pas d’un changement de fond, mais d’une clarification terminologique visant à mieux refléter l’idée selon laquelle l’enrichissement doit être corrigé lorsqu’il est dépourvu de justification légitime.
Comment choisir entre les deux ?
L’enrichissement injustifié ne peut être invoqué qu’à condition qu’aucune autre action ne soit ouverte à l’appauvri ( C. civ., art. 1303-3 ). C’est ce qu’on appelle la subsidiarité de l’ enrichissement injustifié. Cette subsidiarité opère notamment à l’égard des autres actions quasi contractuelles. Il en résulte une hiérarchie entre les quasi-contrats nommés : le demandeur ne peut exercer une action fondée sur l’ enrichissement injustifié, que s’il ne dispose pas d’une action fondée sur la gestion d’affaires ou sur le paiement de l’ indu . La règle résulte de deux articles du Code civil. L’ article 1301-5 du Code civil la formule explicitement à propos de la gestion d’affaires : “Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’ enrichissement injustifié”. L’ article 1303 du Code civil la rappelle, quoique moins explicitement, au sujet à la fois de la gestion d’affaires et du paiement de l’ indu : l’ enrichissement injustifié est concevable “en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’ indu “.