L’autorité de la chose jugée désigne l’ensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle, telle la force de vérité légale, qui ne peuvent pas être remis en cause en dehors des voies de recours habituelles (appel, cassation, révision, opposition).
En revanche, la force de la chose jugée renvoie au caractère exécutoire de la décision. Une décision ayant force de chose jugée peut être mise en exécution par les moyens légaux, tels que la saisie ou l’exécution forcée.
Ainsi, l’autorité de la chose jugée concerne l’irrévocabilité d’une décision, tandis que la force de la chose jugée porte sur son application concrète et son exécution.
Distinction entre l’autorité et la force de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée et la force de chose jugée se distinguent par leurs effets respectifs.
L‘autorité de la chose jugée interdit aux parties de remettre en cause la vérité judiciaire établie par la décision (peu importe son caractère exécutoire ou qu’elle fasse l’objet d’un recours) , tandis que la force de la chose jugée permet de faire exécuter ce jugement. L’autorité de la chose jugée signifie que la chose jugée est tenue pour la vérité alors que la force de chose jugée rend la décision de justice exécutoire.
L’autorité de la chose jugée est le fait que la décision, peu importe son caractère exécutoire ou non, devient la vérité judiciaire des parties qui peut être opposée entre eux et vis à vis des tiers et qu’aucun juge ne peut ignorer, sauf le juge saisi d’un recours contre la décision. L’autorité de la chose jugée n’a aucun lien avec un quelconque caractère exécutoire. L’autorité de la chose jugée vient simplement graver dans le marbre une vérité judiciaire jusqu’à un éventuel recours.
L’autorité de la chose jugée peut être remise en cause par des voies de recours ordinaires (appel, opposition) ou extraordinaires (cassation, tierce opposition, révision) qui n’ont aucune incidence sur la force de la chose jugée (permettant l’exécution), sauf si le juge en décide autrement.
La force de la chose jugée répond à la question : “puis-je faire exécuter la décision ?”, alors que l’autorité de la chose jugée répond à la question “puis-je opposer la vérité judiciaire établie par ce jugement ?”.
Autrement dit :
- L’autorité de la chose jugée permet d’opposer les termes du jugement (ce qui a été jugé) à l’autre partie dans une autre procédure ou dans une autre situation extrajudiciaire ;
- La force de la chose jugée permet de procéder à l’exécution du jugement.
Prenons un exemple : un bailleur qui obtient devant le juge du fond la résiliation de bail par une décision au fond de première instance non exécutoire et frappée d’appel pourra, si un litige a lieu parallèlement devant le juge des référés entre l’occupant sans droit ni titre et le bailleur dans laquelle l’occupant invoque des dispositions du contrat de bail ou de la loi sur le bail, opposer au juge des référés l’absence de bail puisque cette conclusion juridique a autorité de la chose jugée (dès son prononcé) même si elle n’a pas force de la chose jugée (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 2005, 02-20.513). Cela donne un effet semi exécutoire à la décision de première instance vis à vis d’un juge du provisoire.
Dans quel cas un jugement peut avoir autorité de chose jugée sans force de chose jugée ?
Un jugement de première instance a autorité de chose jugée dès son prononcé avant même d’avoir été signifié (Civ. 3 janv. 1979). Si l’exécution provisoire a été écartée (par le juge du fond ou par le premier président), la force exécutoire du jugement est suspendue mais cet appel n’en suspend pas l’autorité de la chose jugée, laquelle subsiste aussi longtemps qu’il n’a pas été réformé. L’appel ne suspend pas l’autorité de la chose jugée, peu importe le caractère exécutoire de la décision de première instance. (Cass. 1re civ., 11 juin 1991, n° 88-18.130)
L’article 561 CPC définit l’appel comme étant une voie de recours qui « remet la chose jugée en question » QUE « devant la juridiction d’appel » (Civ. 7 févr. 1979, Bull. civ. II, n° 35, p. 27 ; Com. 16 juill. 1980, Bull. civ. IV, n° 298, p. 242, JCP 1980.IV.369), et non pas devant la juridiction de première instance qui serait saisie de la même question litigieuse.
Dans quel cas un jugement peut avoir force de chose jugée sans autorité de chose jugée ?
C’est IMPOSSIBLE : le fait pour un jugement de « passer en force de chose jugée » implique que déjà il a acquis cette autorité de la chose jugée dès son prononcé.
L’autorité de la chose jugée est un préalable à la force de chose jugée : on ne peut exécuter une décision que si elle a autorité de la chose jugée.
Un jugement ne peut jamais avoir force de chose jugée sans avoir autorité de chose jugée. En effet, l’autorité de la chose jugée est une condition préalable à la reconnaissance de la force de chose jugée.
Un jugement non définitif peut il avoir autorité de la chose jugée ?
Bien sur ! Un jugement de première instance a autorité de chose jugée dès son prononcé avant même d’avoir été signifié (Civ. 3 janv. 1979). Ce jugement de première instance pourra être infirmé en appel, et cet arrêt lui même cassé devant la Cour de Cassation. L’autorité de la chose jugée n’a aucun lien avec le caractère définitif ou non de la décision.
Quelle différence entre l’autorité de la chose jugée et le dessaisissement
L’autorité de la chose jugée ne doit pas être confondue avec la règle du dessaisissement du juge (CPC, art. 481), qui interdit à ce dernier de revenir sur sa décision pour la modifier ou la compléter, soit de sa propre initiative, soit avec l’accord des parties. Même lorsque le juge interprète son jugement (CPC, art. 461), répare une erreur ou une omission matérielle affectant sa décision (CPC, art. 462) ou complète ou retranche son jugement (CPC, art. 464), il lui est interdit de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Quelle différence entre l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire ?
La force exécutoire ne doit pas être confondue avec l’autorité de la chose jugée.
La force exécutoire exprime la potentialité de puissance contraignante de l’acte
L’autorité de chose jugée s’analyse en une impossibilité d’ouvrir ou de rouvrir devant un juge un débat sur l’existence, la validité ou l’étendue de l’obligation constatée par l’acte, dès lors que l’identité de parties, d’objet et de cause n’est pas contestée.
Quels sont les effets d’un appel ?
L’appel d’une décision de justice de première instance au fond :
- La force de chose jugée (force exécutoire) n’est pas suspendue, sauf dans le cas où le juge en décide autrement
- L’autorité de la chose jugée subsiste aussi longtemps que le jugement n’a pas été infirmé, et donc jusqu’au jour où un arrêt infirmatif aura été rendu.
Exemple avec (Com. 5 oct. 2010, n° 09-70.218) :
une association avait passé avec une société un marché de travaux dans lequel figurait une clause de pénalités de retard. Les délais prévus ayant été dépassés, au moment de payer le prix convenu, l’association invoqua la clause pour déduire du solde le montant des pénalités de retard. Un jugement, rendu le 2 décembre 2004, fit droit à cette demande de compensation, contre lequel la société fit appel. Mais quelques mois plus tard, cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire, lorsque l’affaire est venue devant la cour, la créance portant sur les pénalités de retard a été rejetée et l’association condamnée à payer l’intégralité du prix, au motif que cette derrière « n’avait déclaré aucune créance au passif de la société dont la procédure collective n’avait été ouverte qu’après le jugement ».
L’association devait-elle déclarer cette créance au passif de la société, alors que, du fait de la déduction opérée par le jugement du 2 décembre 2004, la créance de pénalités avait été éteinte par compensation avant l’ouverture de la procédure collective et qu’il y avait donc autorité de chose jugée sur le fait que cette créance n’existait plus ?
Peu importe que ledit jugement ait été frappé d’appel : « la compensation opérée par le jugement du 2 décembre 2004, fût-il frappé d’appel, avait acquis, dès son prononcé, autorité de la chose jugée et, assorti de l’exécution provisoire, avait force exécutoire, de sorte que l’association n’avait pas à déclarer une créance qui avait été éteinte avant l’ouverture de la procédure collective de la société ».
Mon avis personnel sur cette distinction
Vous trouvez cette distinction entre autorité et force de chose jugée peu claire, voire abscons ? Je peux difficilement vous contredire. Il s’agit selon moi d’une argutie juridique du même niveau que la distinction entre preuve déloyale et preuve illicite, que la Cour de Cassation a abandonnée récemment (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648).
La distinction avait un intérêt à l’époque où l’appel avait un effet suspensif : il faut parler de cette époque (que je n’ai pas vraiment connue puisque avant même la modification législative les tribunaux prononçaient en masse l’exécution provisoire) durant laquelle 99% des décisions de première instance n’étaient pas exécutoires si un appel avait lieu. Il était donc nécessaire de créer un concept juridique (force de chose jugée) qui pemettait, alors qu’un pourvoi en cassation était formé, de la faire exécuter. En effet à l’époque la force de chose jugée ne s’acquérait qu’une fois toutes les voies de recours ordinaires expirées et alors même que les voies de recours extraordinaires étaient encort ouvertes (cassation, révision et tierce opposition). L’autorité de la chose jugée était également une manière pour le juge des référés éventuellement saisi en parallèle de donner un caractère semi exécutoire à la décision de première instance en lui faisant avoir des effets qui viennent neutraliser son office.
Aujourd’hui, avec l’exécution provisoire de droit, la force de chose jugée est devenue commune dès la décision de première instance et se confond donc avec l’autorité de la chose jugée sur son moment de naissance, je serai pour abadonner ce concept de force de chose jugée au profit de celui de “décision exécutoire”, qui est bien plus parlant et permet d’éviter toute confusion avec le terme d’autorité de chose jugée.
Proposition : arrêter de parler de “force de chose jugée” mais uniquement de “force exécutoire”
Autorité de la chose jugée (vérité judiciaire)
Le principe (définition)
Aux termes de l’article 480 CPC:
“Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. “
L’autorité de la chose jugée est l’ensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle, telle la force de vérité légale. Elle signifie que la chose jugée est tenue pour la vérité : Res judicita pro veritate habetur. Elle est un attribut du jugement qui assure l’immutabilité aux décisions de justice.
“L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Article 1355 du code civil
L’autorité de la chose jugée ne s’impose qu’aux parties.
L’autorité de la chose jugée s’attache aux décisions judiciaires quels que soient les vices qui les affectent (Cass. 3e civ., 7 déc. 1988 : JCP 1989, IV, 48). L’autorité de la chose jugée s’impose même en cas de méconnaissance d’un principe d’ordre public (Cass. 2e civ., 25 oct. 2007, n° 06-19.524, Bull. 2007, II, N° 241).
Quelles sont les conditions ?
L’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée (C. civ., art. 1355).
Il faut que la chose soit :
- la même demande (identité d’objet)
- fondée sur la même cause (identité de cause). La jurisprudence a renouvelé la conception de l’identité de cause en instaurant un principe de concentration des moyens en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l’instance initiale tous les moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass., ass. plén., 7 juill. 2006, Cesareo, n° 04-10.672). S’il s’en abstient, toute nouvelle demande fondée sur des arguments différents se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée (C. pr. civ., art. 122). Ce principe a ensuite été étendu au défendeur qui se voit contraint de présenter tous les moyens qu’il estime de nature à provoquer le rejet des prétentions formulées à son encontre (Com. 20 févr. 2007, n° 05-18.322 ; Civ. 2e, 27 févr. 2020, nos 18-23.972, 18-23.370).
- concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité de parties).
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque :
- des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-10.614)
Localisation de l’autorité de la chose jugée : le dispositif
” L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif » (Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, P + B + R + I,)
Les motifs du jugement, fussent-ils le soutien nécessaire des dispositifs comme les motifs décisoires, n’ont pas l’autorité de la chose jugée (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 21-11.235)
Moment de l’autorité de chose jugée
Un jugement a autorité de chose jugée dès son prononcé avant même d’avoir été signifié (Civ. 3 janv. 1979, Bull. civ. II, n° 3, p. 2, D. 1979.IR.510, obs. Julien ; Civ. 25 mars 1985, JCP 1987.II.20823, note A. Blaisse, Gaz. Pal. 1985.2.panor.199)
Si un appel suspend la force exécutoire d’un jugement, il n’en suspend pas l’autorité, laquelle subsiste aussi longtemps qu’il n’a pas été réformé.
Les effets
L’autorité de la chose jugée entraîne deux séries de conséquences :
- d’un point de vue positif, le plaideur dont le droit a été consacré par une décision de justice, peut utiliser la chose jugée par la décision pour faire reconnaître ce droit et l’opposer aux tiers ;
- d’un point de vue négatif, le plaideur qui a succombé ne peut plus remettre en cause la décision (sauf à exercer les recours ouverts) : s’il formait une seconde demande ayant le même objet et la même cause contre le même adversaire, celle-ci serait déclarée irrecevable (CPC, art. 122).
Par exemple, Le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, non assorti de l’exécution provisoire, est frappé d’appel. Il s’ensuit qu’une cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui avait été précédemment jugé par un tribunal paritaire des baux ruraux. Cass. 2e civ., 10 mars 2005, n° 02-20.513, Bull. 2005 II N° 60 p. 56. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2005/JURITEXT000007051226
Quels jugements ont autorité de chose jugée ?
Les jugements au fond même de première instance
Seuls les jugements définitifs et non provisoires (provisoire ne veut pas dire que ça exclut la première instance mais veut dire décision “sur le fond” et non par exemple de référé) ont autorité de chose jugée (article 480 CPC).
Les décisions du juge de l’exécution
Aux termes de l’article R. 121-14 du Code des procédures civiles d’ exécution : « Sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal ».
Les jugements rendus par le juge de l’exécution ont pleinement autorité de la chose jugée , de sorte qu’une partie pourra, si elle présente une demande identique devant tout autre juge , se voir opposer l’autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens (Cass. 2e civ., 9 nov. 2000, n° 98-20.124 – Cass. 1re civ., 20 janv. 2011, n° 09-12.608 ; Cass. 2e civ., 22 juin 2016, n° 15-12.954. – Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 12-28.292 : ).
Cette autorité existe même lorsque le juge de l’exécution a outrepassé ses pouvoirs juridictionnels (Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 16-28.530), ce qui oblige parties et juge à une grande vigilance : le juge de l’exécution doit se garder, tout spécialement en matière conservatoire, de trancher ce qui ne lui appartient pas.
Les décisions n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal
Que signifie avoir “autorité de chose jugée au principal” :
- Ces décisions ne lient pas le juge du fond, c’est-à-dire le juge qui tranchant le principal.
- Ces décisions lient néanmoins le juge les ayant prononcées qui ne pourra les modifier qu’en cas de circonstances nouvelles (“petite” autorité de la chose jugée)
L’ordonnance sur requête, aux termes de l’article 493 du Code de procédure civile, est une décision provisoire rendue non contradictoirement n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal. En conséquence, le juge qui a accueilli favorablement la requête peut toujours modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire (CPC, art. 497).
L’ordonnance de référé est une décision n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal (CPC, art. 488, al. 1er ) mais le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision, aussi longtemps qu’un fait nouveau n’a pas modifié les circonstances qui avaient été à l’origine de la mesure (CPC, art. 488, al. 2 ).
Les décisions rendues par un magistrat instructeur
Les décisions des magistrats instructeurs sont provisoires n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il en est ainsi pour les ordonnances du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire (CPC, art. 794 ),pour celles du juge chargé d’instruire l’affaire devant le tribunal de commerce (CPC, art. 867),pour celles du conseiller de la mise en état (CPC, art. 914) et du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans la procédure sans représentation obligatoire (CPC, art. 945 ).
Par exception, les ordonnances qui statuent sur les exceptions de procédure ou sur les incidents mettant fin à l’instance ou sur les fins de non-recevoir et la question de fond dont dépend la fin de non-recevoir, ont autorité de la chose jugée au principal (CPC, art. 794).
La Cour de cassation a jugé que l’ordonnance a autorité de chose jugée qu’elle mette fin à l’instance, ou non (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-15.994, FS-P+B).
En appel, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l’appel ou des conclusions, ou sur la caducité de la déclaration d’appel, ont autorité de la chose jugée au principal (CPC, art. 914) et peuvent être déférées à la cour d’appel (CPC, art. 916).
La force de chose jugée (force exécutoire)
La force de chose jugée est l’efficacité particulière qu’a (ou obtient) une décision de justice lorsque, n’étant pas (ou plus) susceptible d’une voie de recours suspensive, elle est (ou devient) exécutoire.
La décision passée en force de chose jugée, c’est-à-dire qui n’est plus susceptible de recours suspensif, peut être mise à exécution.
Principe
A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
Article 500 du Code de procédure civile
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
Article 501 du Code de procédure civile
La force de chose jugée s’acquiert dès l’expiration des délais d’exercice des recours suspensifs ou à compter du prononcé en cas d’exécution de droit à titre provisoire (CPC, art. 514)
Un jugement a force de chose jugée dans deux hypothèses :
- 1re hypothèse: le jugement a force de chose jugée lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (art. 500, al. 1), c’est-à-dire qu’il n’est pas susceptible d’appel ou d’opposition (art. 527 et 539).
- 2° hypothèse: dans le cas où le jugement est susceptible d’un recours suspensif d’exécution, il passe en force de chose jugée à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai (art. 500 al. 2). Pour prouver qu’un jugement n’a pas fait l’objet d’un appel ou d’une opposition, « toute partie peut se faire délivrer par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l’absence d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation (…) » (art. 505).
Exceptions
L’article 501 du Code de procédure civile pose deux exceptions à la condition de force de chose jugée.
En premier lieu, même si un jugement a force de chose jugée, il n’est pas exécutoire si le débiteur bénéficie d’un délai de grâce.
En second lieu, si le jugement n’a pas force de chose jugée, il est exécutoire dès lors qu’il est doté de l’exécution provisoire.
La première exception fait échec à la force exécutoire alors pourtant que le jugement a force de chose jugée tandis que, à l’inverse, la seconde exception permet à un jugement d’avoir force exécutoire alors pourtant qu’il n’a pas force de chose jugée.
Sources
Appel. Effet suspensif : son incidence sur la chose jugée – Roger Perrot – RTD civ. 1992. 187
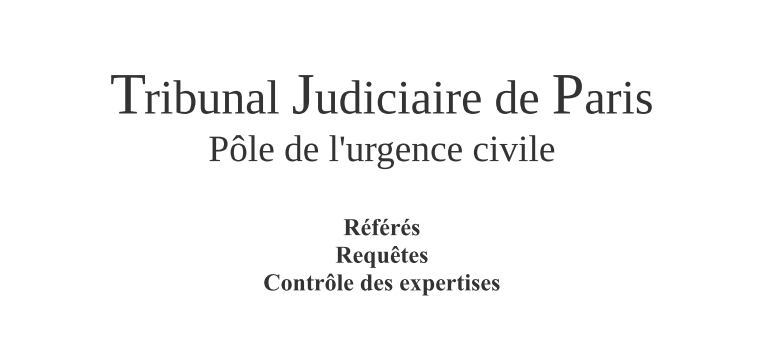
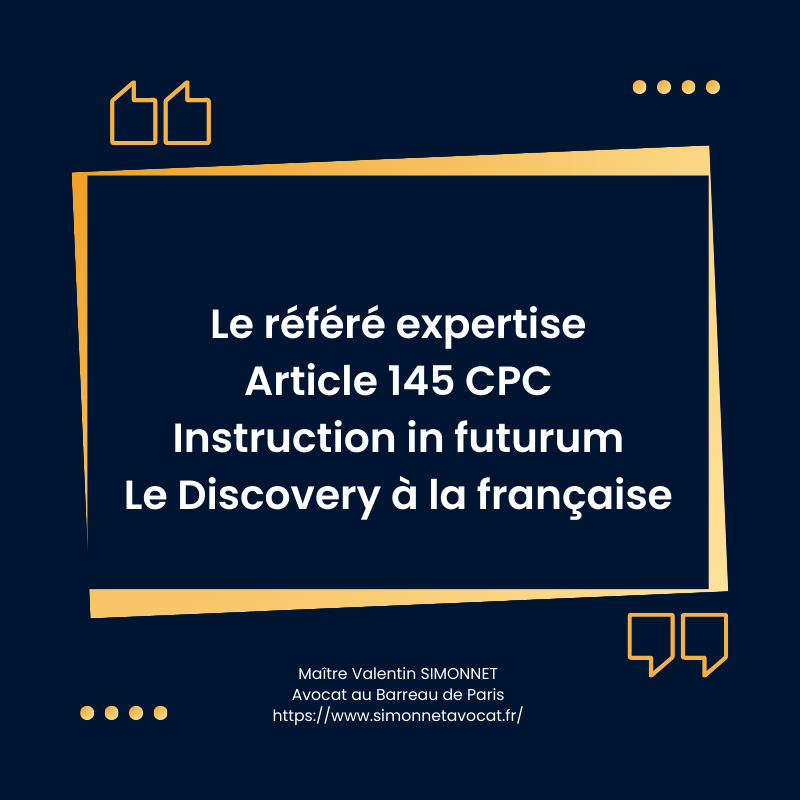
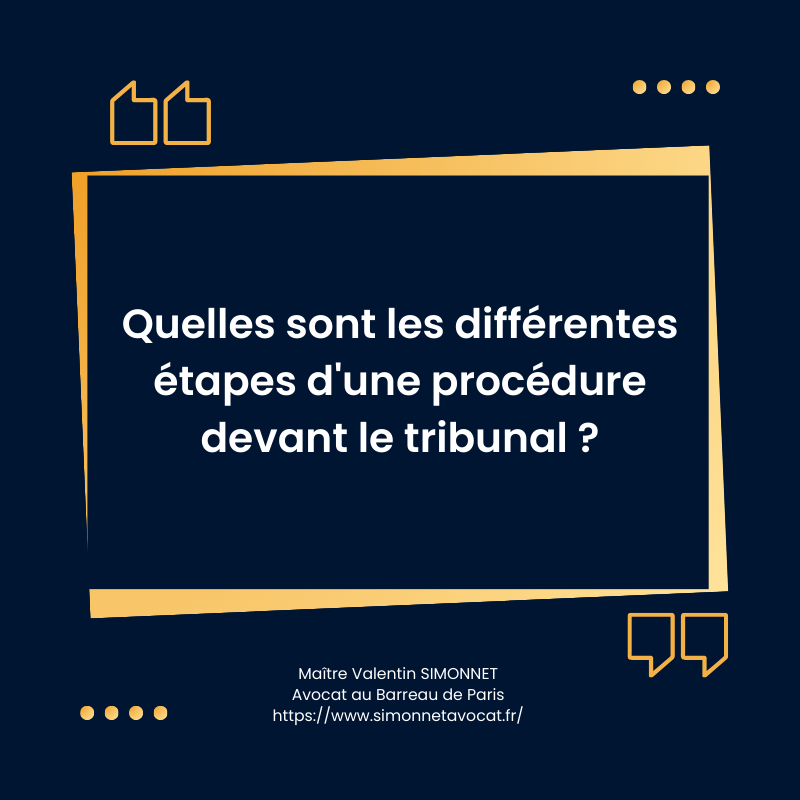
Je suis en surendettement, un litige m’a opposée à mon avocat qui a agi contre mes intérêts , je refuse de régler une facture de 733€ pour une audience que j’avais refusée car elle était inutile , enfin n’ayant pas pu m’entendre à l’amiable, il m’a fait convoquée à la Maison des Avocats qui a pris son parti, ignorant mes explications j’ai fait appel mais n’ayant pas été présente à Douai, on a donné raison à mon avocat , il m’a alors envoyé de suite un huissier me réclamant plus que je ne devais.
J’ai déposé le dossier en surendettement car je ne pouvais payer mais en indiquant la somme exacte et non celle que l’avocat annonce .
Cet avocat prétend que les décisions du Bâtonnier et l’appel prévalent sur la décision que pourrait prendre le juge des contentieux , je voudrais savoir pourquoi et quel est l’article qui le stipule , pouvez-vous m’aider, je ne peux plus prendre d’avocat. Merci